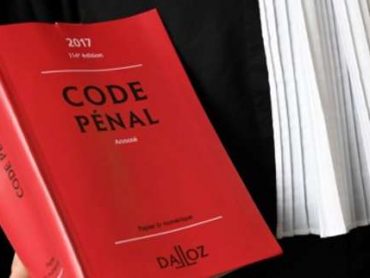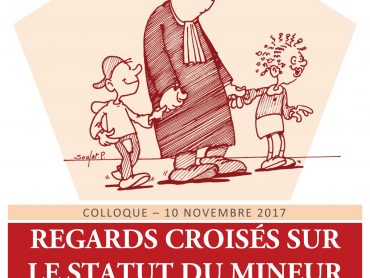Tribune : « La France doit inscrire le consentement au cœur de l’infraction de viol »
Tribune : « La France doit inscrire le consentement au cœur de l’infraction de viol »

La loi pénale française réprimant le viol repose sur un impensé. L’article 222-23 du code pénal, qui définit le viol, indique qu’il s’agit de « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». La notion de consentement ne figure pas dans cette définition.
En l’état actuel du droit pénal, c’est à la victime, au procureur de la République et au juge d’instruction de démontrer que l’auteur a usé de violence, contrainte, menace, ou agi par surprise. Sans cela, l’infraction n’est pas caractérisée.
Indéniablement, punir un acte sexuel car il a été commis en l’absence de consentement de la victime sans inscrire cette notion de consentement au cœur de la loi conduit à un traitement judiciaire des viols semé d’embûches, source de grandes désillusions pour les victimes. Comment prouver que l’acte était violent quand la victime n’a pas eu la force de résister ou n’a pas pu s’opposer ? Comment attester que l’auteur avait placé la victime dans une situation de contrainte morale annihilant tout consentement ? Comment établir le défaut de consentement quand celui-ci est un fantôme dans la loi ?
« Prouvez-moi qu’elle n’était pas consentante ! Elle ne s’est pas défendue, ne s’est pas débattue, n’a pas crié… C’est donc qu’elle était consentante », entend-on souvent de la bouche des mis en cause lors des audiences, faisant ainsi porter une culpabilité supplémentaire sur la victime. Or celle-ci peut être incapable de réagir, de se débattre et de dire non sous l’effet de la peur, par crainte de représailles ou par sidération psychique notamment.
Alors que les violences sexuelles et sexistes sont au cœur des politiques pénales contemporaines, et que de nombreuses voix s’élèvent pour les dénoncer et demander une lutte plus efficace contre cette criminalité endémique, la France ne peut plus conserver sa législation en l’état et doit enfin intégrer clairement la notion de consentement dans l’infraction de viol. Les textes européens appellent largement à une telle évolution.
Exploitation sexuelle
La convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), signée le 11 mai 2011 et ratifiée en 2014 par la France, est à cet égard sans aucune ambiguïté. L’article 36, alinéa 2, énonce ainsi, à propos du viol, que « le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes ». La France, liée juridiquement par la convention, ne peut ignorer cette injonction d’intégrer l’exigence d’un consentement libre comme élément préalable à tout acte sexuel.
Cette mutation est préconisée également dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 8 mars 2022. En effet, l’article 5, alinéas 2 et 3, énonce que « les Etats membres veillent à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée ». Le consentement de la victime est ainsi au cœur du dispositif. Or la France s’oppose à cette proposition de directive, arguant notamment du fait que le viol ne relève pas du domaine de compétence de l’Union européenne (UE), ce qui est discutable, puisque l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’UE précise que l’exploitation sexuelle relève de sa compétence, le viol pouvant être une manifestation de l’exploitation sexuelle. Il semble surtout qu’exiger de l’auteur qu’il démontre avoir sollicité le consentement de son ou sa partenaire avant tout acte sexuel soit en réalité le point d’achoppement pour la France. Or comment expliquer à une victime qu’il serait trop compliqué d’imposer à un homme de lui demander son accord, de vérifier qu’elle accepte avant tout acte sexuel ?
Changement de perspective
Si un homme s’empare frauduleusement d’un objet, il peut être condamné pour vol. Il n’est pas nécessaire que la victime lui ait manifesté verbalement ou physiquement son désaccord. Imaginerait-on exiger de la victime qu’elle se soit débattue ou opposée formellement ? Non, il va de soi que s’approprier un bien contre la volonté de son propriétaire est interdit. Le seul moyen pour que le mis en cause échappe à une condamnation est qu’il démontre que le propriétaire était d’accord pour lui remettre l’objet, qu’il avait donné son consentement. Comment expliquer que le corps d’une victime, son intégrité, sa dignité soient moins bien protégés ?
Notre cadre juridique est la résultante d’évolutions sociales, sociologiques, historiques et de choix politiques. Il n’est pas un cadre figé. Il peut évoluer. De nombreux pays ont déjà placé le consentement au cœur du débat sans que la vie sexuelle de leurs compatriotes en paraisse outre mesure affectée et sans que les juridictions soient encombrées d’innombrables dossiers.
Les Canadiens ont défini le consentement sexuel dans la loi et décrit les situations dans lesquelles il ne peut être valablement exprimé dès 1983. En Europe, l’Allemagne, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, le Luxembourg, Malte, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède et la Suisse définissent le viol comme un rapport sexuel non consenti. En mars 2022, la Belgique a modifié elle aussi sa législation pour inscrire l’exigence d’un consentement libre au nom du droit à l’autodétermination sexuelle. Nous pourrions tirer profit de ces exemples et nous en inspirer.
Intégrer la notion de consentement donné librement dans la loi pénale relative au viol est tout sauf anecdotique. Il ne s’agit pas d’un simple changement de vocabulaire, d’une simple correction sémantique. C’est bien au contraire à un changement de perspective dans l’appréhension judiciaire des violences sexuelles que cette correction aboutirait. Il appartiendrait à l’homme mis en cause de démontrer que la victime avait exprimé librement son consentement à l’acte sexuel concerné, et cela empêcherait l’auteur de se dédouaner en disant qu’elle ne s’était pas opposée.
Modifier la loi pénale en faisant enfin entrer la notion de consentement dans les textes est un premier pas. Nul espoir déraisonné de notre part, nulle naïveté excessive, le mot « consentement » dans la loi pénale ne bouleversera pas le traitement judiciaire des viols. Mais il pourrait être la première marche vers un changement des mentalités qui lui seul pourra garantir une meilleure prise en considération des victimes et dessiner une société plus respectueuse d’autrui. Parfois, le droit court après l’évolution sociale ; parfois, il génère une réflexion collective salvatrice.
Audrey Darsonville est professeure de droit pénal à l’université Paris-Nanterre ;
François Lavallière est magistrat, maître de conférences associé à l’Institut d’études politiques de Rennes.

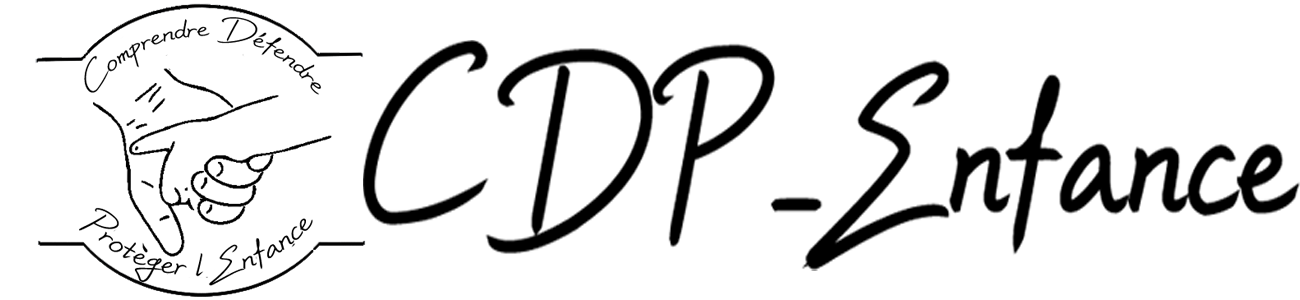










































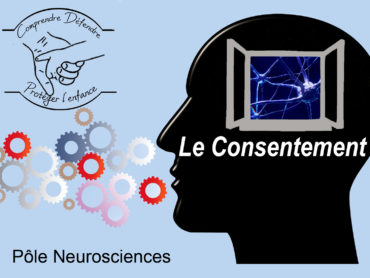



















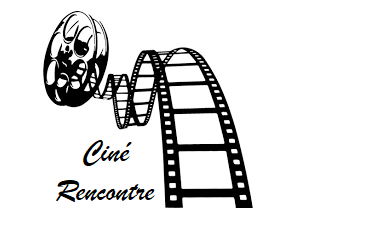
![[Actualité action sociale] L'actualité TSA : Associations et avocats d’enfants dénoncent le traitement réservé aux MNA](https://www.cdpenfance.fr/wp-content/uploads/2018/12/logotsa2petit-1-370x278.jpg)















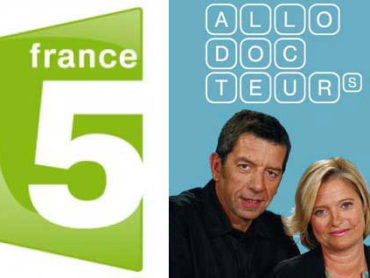


















![[CHIFRES] 22 % des Français se disent victimes de maltraitance infantile - Carenews](https://www.cdpenfance.fr/wp-content/uploads/2017/12/carenews-370x229.png)